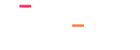Histoire et architecture | Chapelle des Carmélites
Nichée au cœur du centre historique, la Chapelle des Carmélites se dévoile derrière un porche discret et une petite cour. Derrière cette apparente sobriété se cache un trésor artistique unique, souvent surnommé la « Chapelle Sixtine toulousaine ».
Un écrin baroque au cœur de Toulouse
La chapelle est l’un des secrets les mieux gardés de Toulouse ! Véritable joyau baroque, elle séduit tant par son décor somptueux que par son atmosphère contemplative. L’architecture des Carmélites est d’ailleurs un exemple frappant du style baroque en Occitanie.
Ancien couvent du XVIIᵉ siècle, il témoigne de plus de trois siècles d’histoire. Un lieu à découvrir en autonomie, en compagnie d’un guide ou à l’aide de notre mallette pédagogique !

Les Carmélites, des origines à la fondation de la chapelle
Un ordre réformé qui s’épanouit à Toulouse
Né sur le mont Carmel, en Terre sainte, au XIIᵉ siècle, l’ordre du Carmel puise son inspiration dans la vie du prophète Élie : solitude, prière et contemplation. Réformé par Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, cette nouvelle branche prône une vie austère. C’est en 1616 que les premières Carmélites déchaussées arrivent à Toulouse, alors capitale du Languedoc et bastion catholique au cœur d’un Midi marqué par le protestantisme. Elles s’installent définitivement en 1625.
La pose de la première pierre
Le 1ᵉʳ juillet 1622, Louis XIII et Anne d’Autriche posent la première pierre du couvent. Malgré la promesse royale d’appui financier, celle-ci ne se concrétise pas. Le soutien de Guillaume de Rességuier, président des Enquêtes au Parlement de Toulouse, permet le lancement du chantier. L’architecte Didier Sansonnet conçoit un édifice fidèle aux principes de la Contre-Réforme : une façade sobre et un intérieur fastueux, destiné à émouvoir et instruire les fidèles.
Un monument rescapé
Achevée peu après 1643, la chapelle est la seule partie encore visible du couvent, détruit après la Révolution. Elle connaîtra ensuite divers usages : caserne, prison, chapelle du Grand Séminaire, musée de moulages. Désacralisée, elle ouvre au public en 1975 et devient propriété de la ville en 2007.
Une architecture entre sobriété et magnificence
Une organisation interne conventionnelle
La chapelle est organisée selon un plan simple et fonctionnel. Elle présente une nef unique de 29 mètres, composée de quatre travées et surmontée d’une voûte en bois. Celle-ci repose sur des ogives et culots, ce qui donne une sensation de profondeur et de continuité. L’abside à trois pans prolonge le chœur.
C’est un lieu pensé pour favoriser la concentration et la séparation des fonctions religieuses. Comme dans toute église conventuelle carmélite, l’espace respectait la règle stricte de la clôture : derrière une double grille, le chœur des sœurs permettait aux religieuses d’assister à la messe sans être vues.
Un contraste marqué entre l’intérieur et l’extérieur
Un extérieur simple
À l’image de l’idéal carmélitain et des principes de la Contre-Réforme, la façade de la Chapelle des Carmélites affiche une grande sobriété. Construite en brique foraine, matériau local et économique typique de Toulouse, elle est presque dépourvue d’ornements. Les lignes sont droites, la composition austère, et seule la porte d’entrée, encadrée de pierre, marque un point d’attention.
Aucune monumentalité ostentatoire. L’édifice se fond dans le tissu urbain de la rue de Périgord, à tel point que l’on pourrait passer devant sans soupçonner l’extraordinaire décor baroque qu’elle recèle.
Ce contraste — façade humble, intérieur somptueux — est un choix délibéré, pensé pour orienter la beauté et la richesse vers l’espace sacré, invisible de l’extérieur, et préserver l’esprit de pauvreté de l’ordre.
Une décor peint d’exception
À l’intérieur, au contraire, le décor baroque exalte la foi par la richesse des formes et des couleurs. Réalisées par des artistes toulousains, ces peintures font partie d’un chantier qui a pris fin presque 60 ans après la premier coup de pinceau !
Au XVIIᵉ siècle, Jean-Pierre Rivalz conçoit les grandes lignes décoratives et peint les figures allégoriques près du chœur : Charité, Foi, Silence, Contemplation.
Au XVIIIᵉ siècle, son arrière-petit-gendre Jean-Baptiste Despax achève l’œuvre : plafonds peints, scènes de l’Ancien Testament, épisodes de la vie du Christ et l’impressionnante Apothéose de Sainte Thérèse d’Avila.
Ces fresques, inspirées par le baroque italien, sont conçues pour toucher, instruire et émouvoir — un véritable catéchisme en images. Leur virtuosité a valu à la chapelle le surnom de « Sixtine toulousaine ».
Un lieu culturel et musical vivant
Pensée dès sa construction pour offrir une excellente acoustique, la chapelle est aujourd’hui un espace incontournable de la vie culturelle toulousaine.

Elle accueille la Saison Musicale : concerts de musique classique, ensembles baroques, récitals vocaux, jazz, musiques du monde, mais aussi créations contemporaines, DJ sets et projections vidéo. Les concerts joués à la lueur des bougies, y trouvent un écrin particulièrement magique.
Outre la musique, la chapelle propose des visites guidées, des expositions et des expériences immersives. Un parcours muséographique retrace désormais son histoire et des dispositifs d’accessibilité permettent d’accueillir tous les publics.