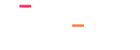Histoire et architecture | Chapelle de La Grave
Perchée sur la rive gauche, dans le quartier de Saint-Cyprien, la Chapelle de La Grave est un symbole iconique de Toulouse, avec son dôme turquoise reconnaissable depuis les quais de la Garonne. Star des cartes postales et muse des photographes, il s’impose comme l’un des monuments incontournables de la ville rose.
Un emblème architectural au bord de la Garonne
Avec son double dôme construit sur pilotis pour résister aux crues de la Garonne, la chapelle s’impose par son profil exceptionnel dans le paysage urbain. Longtemps, seuls les pensionnaires de l’hôpital La Grave y avaient accès. En 2015, le CHU, propriétaire de la chapelle Saint-Joseph, a confié sa gestion à la Mairie de Toulouse. Celle-ci a été restaurée et ouverte aux Toulousains pour partager son histoire.

Histoire hospitalière et mémoire sociale
L’hôpital des pestiférés
La chapelle fait partie de l’ensemble hospitalier de La Grave. Fondé au XIIᵉ siècle par Raymond VI, l’hôpital accueille alors pauvres et malades. À ses débuts, il n’est qu’une modeste structure de quartier. Construit sur une grève de la Garonne, il tire son nom du mot « Grav » , qui signifie « sable ». Une référence à son emplacement initial sur une zone de graviers à proximité du fleuve. Au XIVe siècle, son rôle devient crucial. L’hôpital devient un lieu d’isolement pour les pestiférés, dépassant sa fonction initiale d’hospice de quartier.
Jacques Frexinos, professeur à la faculté de médecine de Toulouse et ancien chef du service de gastro-entérologie du CHU, explique : « Après la première épidémie de peste, en 1348, le ‘fléau de Dieu’ va frapper régulièrement la ville pendant les quatre siècles suivants et provoquer selon la gravité des épidémies entre 10 à 40 % de décès dans la population ».
Au XVIIe siècle, Louis XIV mène la politique du Grand Renfermement. Il ordonne la création d’un Hôpital Général dans chaque grande ville du royaume de France. Si l’idée est de soigner, nourrir, instruire et relever le niveau moral des pauvres, la réalité est tout autre. On y enferme tous ceux qui « dérangent » tels que les orphelins, les vagabonds, les voleurs, les prostituées ou les fous. A noter que les épileptiques, les homosexuels et les véritables malades psychiatriques sont considérés comme déments sans distinction.
La construction de la chapelle débute entre 1758 et 1760 sous la direction l’architecte toulousain Joseph-Marie de Saget.
Le renouveau du site : restauration et aménagement urbain
Restaurée entre 2020 et 2022 pour près de 9 millions d’euros, le monument a retrouvé son éclat patrimonial et ouvert ses portes au public. Il propose des expériences de visite diversifiées et une programmation riche adaptée à tous les âges.
Architecture du dôme et urbanisme du quartier Saint‑Cyprien
Dôme « à la romaine », rotonde en brique et intérieur coloré

Édifiée selon un plan circulaire, la chapelle repose sur un tambour en brique soutenu par huit piliers, coiffée d’un dôme à la romaine de 40 mètres avec lanternes et vitraux cintrés. Devant la façade, six pilastres ioniques soutiennent un fronton inachevé, typique de l’architecture hospitalière toulousaine.
À l’origine, faux marbres et trompe-l’œil peints sur la brique permettaient de colorer l’espace. Altérés par le temps, ces décors ont retrouvé une seconde jeunesse grâce au travail de restauration.
Le site urbain et les jardins du Dôme de La Grave
Depuis 2025, le site, autrefois enclavé, a été réaménagé avec cinq jardins thématiques, un belvédère et une rampe d’accès douce pour rallier au pont. Ce projet mêle urbanisme vert et valorisation du patrimoine culturel.